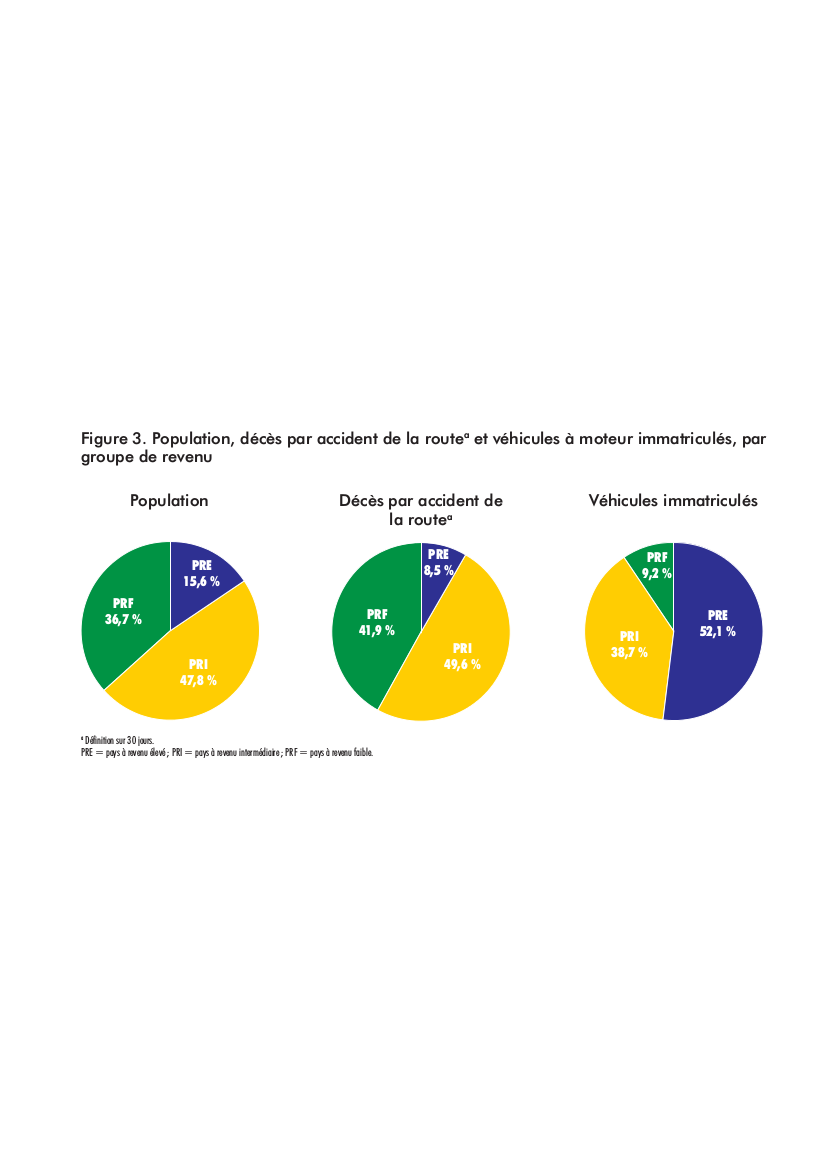La sécurité routière en Europe
Si l’on veut tenter de comparer les pays européens, le nombre de morts rapporté au total de la population est plus parlant : en France, en 2001, on déplore 138 tués pour 1 million d’habitants. Au Royaume-Uni, en Suède, aux Pays-bas, ce chiffre n’est que de 60 à 70. Il est plus élevé en Allemagne (90), en Italie (110) mais surtout en Espagne et en Belgique (140 et 145) ainsi qu’au Luxembourg ( 174) et véritablement catastrophique au Portugal et en Grèce (200 à 210).
France, le bonnet d' âne:
-Le cas français
« Un scandale », voici comment Béatrice Houchard qualifie la situation française. Chaque jour, 22 personnes sont tuées sur les routes de France. Par an, on déplore 8000 décès et 26 000 accidentés. C’est d’autant plus insupportable que l’hécatombe frappe d’abord les jeunes. 26 % des morts sont des jeunes de 18 à 24 ans qui ne représentent pourtant que 13 % de la population totale.
L’examen des caractéristiques de l’hécatombe fait sauter beaucoup d’idées fausses. Ce sont les routes départementales qui sont les plus meurtrières, elles constituent 36,4 % du réseau routier et comptabilisent 53,6 % du nombre de morts, soit 2 fois plus que sur les nationales et 8 fois plus que sur les autoroutes. L’accident-type se produit à la sortie d’une boîte de nuit, dans la nuit du samedi au dimanche, vers 4 ou 5 h du matin. Presque toujours vitesse et alcool expliquent l’accident. Autre accident-type et inattendu : celui qui se produit sur le trajet domicile-travail, sur le chemin de l’école, des courses ou des loisirs. Les ¾ des victimes de la route meurent à moins de 10 km de chez elles, sur un parcours qu’elles connaissent bien.
Qu’est ce qui fonde l’exception française ? Pourquoi la France où sont tués chaque année 20 % des morts européens de la route, ne parvient-elle pas à diminuer le nombre de décès et d’accidentés alors que d’autres pays ont su le faire de manière spectaculaire ?
« L’alcool est une tradition, la vitesse une affaire de virilité » écrit Béatrice Houchard. En France, un accident sur deux est provoqué par une vitesse excessive, l’alcool est responsable de 31 % des accidents mortels et 94 % des automobilistes condamnés pour conduite sous l’emprise de l’alcool sont des hommes.
Les campagnes de prévention demeurent bien timides. Beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation. Mais il faut augmenter le budget et marteler, tout au long de l’année, des campagnes mieux ciblées et plus axées sur les risques quotidiens.
En outre, il apparaît clairement qu’en France, la crainte d’être verbalisé est plus dissuasive que de tuer l’un de ses semblables. Et pourtant, le risque d’être sanctionné est minime. De l’aveu même de la DSCR ( Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières), on n’a que 0,5% de risque d’être arrêté si on roule pendant une heure à une vitesse supérieure de 10 km/h à la vitesse autorisée (soit une fois tous les 15 ans !), 60 % des infractions constatées ne sont suivies d’aucune sanction. Dans le cas précis des condamnations pour infraction aggravée par l’alcool, 59% des condamnés l’ont été à des peine de prison dont 4,5 % seulement ont écopé de prison ferme. C’est là que réside, selon Béatrice Houchard, la véritable différence avec les autres pays européens.
Pourtant, il semble qu’on assiste actuellement à une réelle volonté politique de changer les choses. Le 14 juillet 2002, Jacques Chirac a parlé pour la première fois de la sécurité routière comme l’un des trois chantiers prioritaires de son quinquennat. A la grande différence des années précédentes, non seulement l’impulsion est venue du Président de la République mais les médias télévisés ont aussi relayé le message. Un changement de vocabulaire devient perceptible. Ainsi, en septembre 2002, Jean-Pierre Raffarin a déclaré qu’on ne pouvait plus parler de l’insécurité routière avec « des mots qui mentent » mais avec les « vrais mots, les mots de violence, de délinquance, les mots, quelquefois, d’assassinat » avant de parler, en décembre 2002, de « pathologie nationale ».
Dès lors, une nouvelle politique, votée par le Parlement, le 5 juin 2003, a été mise en place. Elle concerne la multiplication des radars sur les routes, l’aggravation des peines, un permis probatoire pour les plus jeunes et une visite médicale pour les plus âgés. Du coup, les accidents mortels ont reculé de 30 % au cours du premier semestre 2003 par rapport à l’année précédente.
Si chaque Etat doit faire preuve de volonté politique, l’U.E. doit aussi agir.
Pour plus d'Infos:
http://www.fenetreeurope.com/file/2003/file104.htm
Aujourd'hui, la suède reste de loin le pays qui promeut véritablement uen politique de prévention, exemple à suivre. Comme quoi, les bonnes idées ne sont pas une exclusivité de chez nous.